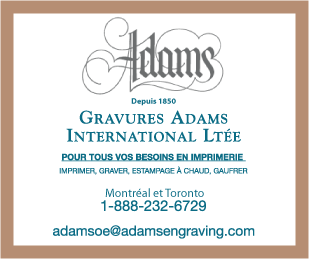Constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État

Texte intégral de l’arrêt : Constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État![]() (3 Mo)
(3 Mo)
English Translation of the Judgment of the Court: Constitutionality of the Act respecting the laicity of the State ![]() (2 Mo)
(2 Mo)
SOMMAIRE
Ce sommaire ne fait pas partie de l’arrêt de la Cour, ne tient pas lieu des motifs de celui-ci et ne doit pas être utilisé dans des procédures judiciaires.
Depuis son adoption, la Loi sur la laïcité de l’État (« Loi ») est objet de controverse. L’on peut certainement entretenir des opinions diverses à son sujet, que ce soit politiquement, sociologiquement ou moralement. L’arrêt de la Cour, toutefois, ne s’intéressera évidemment qu’à l’aspect juridique du débat. La Cour, comme avant elle la Cour supérieure, agit en effet ici dans le cadre d’un processus de contrôle de la légalité de la Loi (processus initié par différents groupes de justiciables) et elle ne statue pas sur la sagesse de celle-ci. (Par. 11 à 14)
L’arrêt de la Cour tranche ainsi le sort de huit appels, de quatre appels incidents et de quatre interventions à l’encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard), lequel déclare inopérantes, sous deux rapports, certaines dispositions de la Loi, qui est validée pour le reste.
Reprenant pour l’essentiel le débat qui s’est déroulé devant la Cour supérieure, la contestation de la Loi en appel comporte deux volets principaux : (1) les arguments constitutionnels non rattachés aux droits fondamentaux et (2) les arguments fondés sur les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et par la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »).
Sous le premier volet, les parties font valoir des arguments liés aux thèmes suivants :
- le partage des compétences législatives (art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 (« LC 1867 »));
- l’effet supralégislatif de certaines lois préconfédératives (Acte de Québec, Loi sur les rectoreries, Loi Hart);
- l’architecture constitutionnelle et les principes non écrits de la Constitution;
- l’art. 31 de la Charte canadienne.
Sous le deuxième volet, les parties invoquent des arguments liés aux thèmes suivants :
- l’usage des dispositions de dérogation prévues dans la Charte canadienne (art. 33) et dans la Charte québécoise (art. 52);
- la violation de certains droits fondamentaux (libertés de conscience, de religion et d’expression; droits à l’égalité) et l’octroi de réparations déclaratoires et pécuniaires;
- l’égalité de garantie des droits pour les personnes des deux sexes (art. 28 de la Charte canadienne et 50.1 de la Charte québécoise);
- les droits à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23 de la Charte canadienne);
- le droit à l’éligibilité aux élections législatives provinciales (art. 3 de la Charte canadienne);
- la validité des exercices de dénombrement menés par le gouvernement avant l’adoption de la Loi.
L’arrêt de la Cour traite successivement de chacun de ces sujets.
* * *
Partie I : Arguments CONSTITUTIONNELS non rattachés aux droits fondamentaux
A. Partage des compétences (Par. 71 à 108)
À l’instar du juge de première instance, mais pour des motifs sensiblement différents, la Cour conclut que la Loi est conforme au partage des compétences législatives déterminé par les art. 91 et 92 la LC 1867.
Lorsque, au regard de ces dispositions, un différend survient sur la validité constitutionnelle d’une loi, la méthode d’analyse pour trancher la question en litige comprend deux étapes. On doit d’abord qualifier la loi contestée (c.-à-d. identifier son « caractère véritable ») puis, par un processus de classification, la rattacher à un ou des paragraphe(s) figurant dans les art. 91 et 92 de la LC 1867.
En l’occurrence, l’objet de la Loi – son caractère véritable – est d’affirmer la laïcité de l’État en tant que principe fondamental du droit public québécois, de fixer les exigences qui en découlent, de garantir le droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques et d’encadrer les conditions d’exercice de certaines fonctions au sein de ces institutions et des organismes de l’État. Le juge de première instance a donc erré en concluant que les art. 6 et 8 de la Loi « s’avèrent relever de la nature de dispositions traitant de la religion dans une perspective se rattachant traditionnellement au droit criminel » (jugement de première instance, par. 417). Cette qualification est indûment étroite et elle confond l’objet de la Loi avec les moyens utilisés pour sa mise en œuvre, et seulement certains, d’ailleurs. Cette erreur est toutefois sans conséquence quant à l’issue du litige. (Par. 101-102)
Au chapitre de la classification de la Loi, le juge a déterminé qu’il lui était impossible de conclure à un empiètement sur la compétence fédérale en matière de droit criminel parce que la Loi « ne comporte pas de sanctions de la nature de celles qui permettraient sa classification comme relevant du droit criminel » (jugement de première instance, par. 434). On pourrait se rallier au constat du juge sur ce point, mais ce serait superflu, car la perspective adoptée par celui‑ci est à l’inverse de celle qui s’imposait. Le juge aurait dû se demander : « Compte tenu de sa qualification, peut‑on fonder la Loi sur l’un ou sur plusieurs des chefs de compétence énumérés à l’art. 92 de la LC 1867? ». La réponse à cette question ne pouvait être qu’affirmative, ce que le juge a d’ailleurs reconnu. Il est clair, en effet, qu’à divers titres, la Loi se rattache simultanément aux par. 92(4) (création et tenure des charges provinciales, nomination et paiement des officiers provinciaux), (13) (propriété et droits civils dans la province) et (16) (matières d’une nature purement locale ou privée) de la LC 1867. De plus, plusieurs dispositions de la Loi se qualifient aux termes de l’art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 (« LC 1982 ») comme modifications à la constitution de la province. Sous aucun rapport la Loi ne peut-elle par ailleurs être considérée comme se rattachant au par. 91(27) de la LC 1867 (droit criminel). (Par. 103 à 107)
B. Lois préconfédératives (Par. 109 à 183)
Selon la Cour, le juge de première instance était bien fondé de rejeter les prétentions des opposants à la Loi fondées sur l’Acte de Québec (1774), la Loi sur les rectoreries (1852) et la Loi Hart (1832). Aucune de ces lois préconfédératives n’a de portée supralégislative et ne peut servir de fondement à l’invalidation de la Loi.
Acte de Québec (1774) (Par. 116 à 148)
L’Acte de Québec est une loi impériale de circonstance, en ce sens qu’elle s’inscrit dans une logique de conquête coloniale. Par leur plaidoirie, les parties opposées à la Loi tentent de donner à cette loi une signification qu’elle n’a jamais eue.
Si l’on garde à l’esprit, comme fil d’Ariane, ce qu’il est advenu du caractère « supralégislatif » des lois impériales au gré des réformes constitutionnelles ayant suivi l’Acte de Québec, on constate que celui-ci n’a cessé de s’étioler, au point, éventuellement, d’être supplanté en totalité par les lois locales et constitutionnelles subséquentes. Tout au long de la période en question, on assiste en effet à une dévolution progressive de la souveraineté législative et constitutionnelle de la Grande‑Bretagne vers le Canada (et donc vers le Québec, dans la mesure des compétences législatives qui lui reviennent). En 1982, au terme de cette longue progression, les anciennes colonies fédérale et provinciales héritent ensemble de la totalité des pouvoirs jusque-là exercés au Canada par le Parlement de Westminster. À partir de ce moment, tout est dit et l’Acte de Québec n’a plus aucune portée sur les lois fédérales ou provinciales. (Par. 139 à 147)
En définitive, l’Acte de Québec est une loi d’intérêt historique, mais dont la jurisprudence ne parle plus depuis longtemps. Cette loi ne peut servir de fondement à l’invalidation de la Loi. Le dossier d’appel ne fait d’ailleurs voir aucun précédent à l’occasion duquel un tribunal aurait fait droit à la contestation constitutionnelle d’une loi du Québec, du Bas-Canada ou de la Province du Canada en se fondant sur des droits affirmés dans l’Acte de Québec. (Par. 148)
Loi sur les rectoreries (1852) (Par. 150 à 176)
La Loi sur les rectoreries est une loi coloniale qui relevait vraisemblablement d’un champ de compétence provincial plus tard assujetti à l’art. 129 de la LC 1867. Après la Confédération, ce sur quoi elle portait relevait donc de la compétence du Québec. Elle s’y est progressivement métamorphosée en la Loi sur la liberté des cultes. Cette dernière loi, avec la Charte québécoise, constitue aujourd’hui la seule trace qui en reste dans les lois du Québec. Force est donc de conclure que la Loi sur les rectoreries est devenue caduque ou est tombée en désuétude.
La prétention selon laquelle la Loi sur les rectoreries eut à une certaine époque une portée supralégislative est mal fondée. Tout comme l’Acte de Québec, la Loi sur les rectoreries et celles qui l’ont suivie n’ont d’ailleurs jamais servi de fondement à l’invalidation d’une loi pour cause d’inconstitutionnalité. Elle ne peut non plus servir de fondement à l’invalidation de la Loi. (Par. 174-175)
Loi Hart (1832) (Par. 177 à 182)
Le juge de première instance a méticuleusement retracé l’évolution de la législation au Bas-Canada et au Québec entre 1832 (année d’adoption de la Loi Hart) et 1888. Il a énuméré les lois qui, durant cette période, ont absorbé et confirmé le principe d’abord énoncé dans la Loi Hart. Bien qu’elle n’ait jamais été abrogée formellement, la Loi Hart a été rendue caduque par les dispositions de ces lois.
Le juge de première instance a également eu raison de rejeter l’argument selon lequel la Loi Hart aurait été incorporée à la Constitution par l’art. 129 LC 1867. L’art. 129 est une disposition transitoire « et non pas attributive d’un statut constitutionnel aux lois en vigueur lors de la Confédération » (jugement de première instance, par. 567). Elle ne peut non plus servir de fondement à l’invalidation de la Loi.
C. Architecture constitutionnelle et principes non écrits (Par. 184 à 201)
De l’avis de la Cour, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté les moyens de contestation de la Loi fondés sur l’architecture constitutionnelle et les principes non écrits de la Constitution.
Rien dans la jurisprudence relative à la notion d’architecture constitutionnelle ne permet d’inférer que les interdictions établies par la Loi menaceraient de quelque façon que ce soit la « structure fondamentale » de la Constitution. Les parties opposées à la Loi ont tenté de démontrer que la Loi déroge à l’architecture constitutionnelle en enfreignant ce qu’elles désignent comme la « Doctrine de participation aux institutions publiques », mais elles n’ont pas été en mesure de préciser l’origine ou la teneur de cette doctrine. Elles ont plaidé que leur prétention trouvait une assise dans l’Acte de Québec, l’Acte constitutionnel de 1791, la Loi sur les rectoreries et la Loi Hart, autant de composantes de la Constitution selon elles. Or, la question de l’effet supralégislatif de ces lois a déjà été vidée. Aucune de ces lois – et rien non plus dans le texte actuel de la Constitution – ne permet de faire droit à leur argument.
Quant aux principes non écrits de la Constitution, il paraît clair, à la lumière de l’arrêt Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, que les notions d’architecture constitutionnelle et de structure constitutionnelle fondamentale ne peuvent recevoir une extension qui permette aux parties opposées à la Loi d’atteindre l’objectif qu’elles recherchent.
Enfin, la Loi est conforme au principe de la primauté du droit. Les parties opposées à la Loi allèguent que ses dispositions (en particulier la définition de « signe religieux » à l’art. 6) sont imprécises et, conséquemment, déficientes sous ce rapport. Elles ont tort. À la lecture des dispositions contestées de la Loi, il est impossible de soutenir qu’elles ne constituent pas « un guide suffisant pour un débat judiciaire ». Ce débat permettra le moment venu de départager les thèses en présence sur la portée de la Loi et d’arrêter une interprétation ferme des dispositions en question. Les arguments des opposants à la Loi fondés sur de prétendues incohérences dans la Loi ou entre la Loi et la Loi sur la neutralité religieuse de l’État sont aussi mal fondés. Il est impossible d’atteindre en droit la clarté et la cohérence absolues recherchées par les parties opposées à la Loi et il est vain d’y aspirer.
D. Article 31 de la Charte canadienne (Par. 202 à 212)
La Cour rejette la contestation de la Loi fondée sur l’art. 31 de la Charte canadienne, disposition prévoyant que la Charte n’élargit pas les compétences législatives « de quelque organisme ou autorité que ce soit ». Ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel.
Les conclusions de la Cour relativement à la validité constitutionnelle de la Loi au regard du partage des compétences et des lois préconfédératives emportent le rejet sommaire de la plupart des arguments présentés sous ce chapitre. Quant à l’argument selon lequel les principes sous-jacents aux lois préconfédératives auraient été constitutionnalisés malgré l’abrogation ou le remplacement de ces lois et permettraient d’invalider la Loi par le truchement de l’art. 31 de la Charte canadienne, il ne résiste pas à l’analyse. (Par. 205)
Tout d’abord, rien ne permet de croire que ces principes ont été constitutionnalisés avant l’adoption de la Charte canadienne. (Par. 209)
Ensuite, le texte écrit de la Constitution (la Charte canadienne) garantit la liberté de religion et permet expressément au législateur d’y apporter des limites (art. 1) ou d’y déroger (art. 33). Faire droit aux prétentions des opposants à la Loi reviendrait à faire abstraction de ce texte pourtant clair et à reconnaître deux libertés de religion distinctes au sein de notre ordre constitutionnel : l’une, non écrite, qui serait implicitement garantie par la Constitution, et à l’égard de laquelle aucune limite ou dérogation ne serait permise, et l’autre, expressément garantie par cette même Constitution, laquelle pourrait être sujette à certaines restrictions ou dérogations. Il y a là un non-sens évident. Les principes constitutionnels non écrits ne peuvent être utilisés de manière à négliger le texte écrit de la Constitution. (Par. 210)
En vérité, les parties opposées à la Loi invitent la Cour à utiliser l’art. 31 de la Charte canadienne pour passer outre aux art. 1 et 33 de cette même charte. Or, une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre. En l’occurrence, rien ne permet de voir en l’art. 31 une limite au pouvoir de dérogation prévu par l’art. 33. (Par. 211)
* * *
Partie II : Arguments fondés sur les droits fondamentaux
A. Recours aux dispositions de dérogation (Par. 213 à 311)
La Cour conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en rejetant la contestation des art. 33 et 34 de la Loi, articles reprenant respectivement le libellé des art. 52 de la Charte québécoise et 33 de la Charte canadienne, lesquels confèrent au législateur le pouvoir de déroger à certaines de leurs propres dispositions.
De l’avis de la Cour, c’est à bon droit que le juge a conclu qu’il était lié par l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 (« Ford »). La lecture que le juge en a faite est exempte d’erreur.
Selon l’arrêt Ford, l’art. 33 de la Charte canadienne n’établit que des conditions de forme, de sorte que l’examen judiciaire de l’exercice du pouvoir de dérogation est strictement limité à l’analyse de ces conditions. Dès lors, les tribunaux ne peuvent exiger que le législateur explique ou justifie le caractère opportun de la politique législative à l’origine de l’exercice de ce pouvoir. Ils ne peuvent non plus exiger que celui-ci atteste l’existence d’un lien ou d’un rapport entre la loi ou la disposition dérogatoire et les droits ou libertés auxquels il est dérogé. Le législateur peut recourir au pouvoir de dérogation prévu par l’art. 33 de la Charte canadienne de façon purement préventive. Ces enseignements de l’arrêt Ford ne relèvent pas de l’obiter, contrairement à ce que prétendent les parties opposées à la Loi. (Par. 244 à 255)
Les principes énoncés dans l’arrêt Ford s’appliquent aussi à l’art. 52 de la Charte québécoise. Le libellé de cet article n’exige rien de plus qu’une déclaration expresse que la loi ou la disposition législative s’applique malgré la Charte québécoise. De plus, les fondements des pouvoirs de dérogation prévus dans les deux chartes sont les mêmes. Or, si des conditions de forme sont suffisantes pour justifier une dérogation aux droits et libertés enchâssés dans la Constitution, elles le sont certainement tout autant pour justifier une dérogation aux dispositions de la Charte québécoise, loi quasi‑constitutionnelle. (Par. 257)
L’arrêt Ford fait toujours autorité. Les opposants à la Loi ne font voir aucune question juridique nouvelle qui justifierait de réexaminer ce précédent. (Par. 264 à 298) Ils échouent aussi à établir qu’une modification de la situation ou de la preuve depuis l’époque de cet arrêt changerait radicalement la donne et permettrait de l’écarter. (Par. 302 à 308)
Les art. 33 et 34 de la Loi étant conformes aux conditions de forme établies dans l’arrêt Ford, la contestation des parties opposées à la Loi ne peut réussir sur ce plan. (Par. 311)
B. Violation des droits fondamentaux et réparations déclaratoires ou pécuniaires (Par. 312 à 415)
Tout comme le juge de première instance, mais pour des raisons qui diffèrent partiellement des siennes, la Cour refuse de statuer formellement sur la question de savoir si la Loi contrevient à l’une ou l’autre des dispositions auxquelles s’appliquent les dérogations et, le cas échéant, de prononcer un jugement déclaratoire en ce sens. (Par. 314)
Lorsque, se fondant sur l’art. 33 de la Charte canadienne, le législateur décide de déroger aux art. 2 ou 7 à 15 de cette charte, il se trouve à soustraire la loi à leur application ou à l’en exempter, de sorte qu’elle s’applique sans égard à ces dispositions, à l’abri des conséquences qui résulteraient autrement du par. 52(1) de la LC 1982. Le législateur qui recourt à l’art. 33 de la Charte canadienne se trouve ainsi à limiter le contrôle judiciaire de la constitutionnalité de la loi eu égard aux dispositions visées par la dérogation. Les tribunaux n’ont plus à faire l’exercice qui consisterait à vérifier la conformité de la loi avec la ou les dispositions auxquelles le législateur déroge, et toute idée de réparation – y compris par voie déclaratoire – est dès lors exclue. (Par. 317 à 319, 348 à 350)
La même conclusion s’impose lorsque le législateur use de l’art. 52 de la Charte québécoise pour déroger à l’un ou l’autre des art. 1 à 38 de cette charte. La loi qui contient une déclaration conforme à l’art. 52 est immunisée contre le contrôle judiciaire de sa conformité aux dispositions visées par la dérogation. (Par. 330 et 359)
Le par. 24(1) de la Charte canadienne ne peut être interprété comme habilitant les tribunaux à octroyer une réparation déclaratoire malgré l’usage de l’art. 33, ce qui les obligerait par la force des choses à vérifier préalablement la conformité de la loi aux dispositions auxquelles elle a été soustraite, se livrant ainsi à un exercice qu’empêche précisément l’art. 33. Cela n’est pas possible. Les art. 142 et 529 C.p.c. ne le permettent pas davantage. Pareillement, ni l’art. 49 de la Charte québécoise ni, encore une fois, les art. 142 et 529 C.p.c. ne peuvent entraver l’effet d’une déclaration prise en vertu de l’art. 52 de la Charte québécoise. (Par. 368-369)
En l’espèce, la Cour ne peut donc se prononcer sur la compatibilité (ou l’incompatibilité) de la Loi avec les dispositions des chartes à l’application desquelles elle a été soustraite. Plus spécifiquement, la Cour n’est pas habilitée à statuer sur la question de savoir si la Loi porte atteinte aux libertés de religion et d’expression ou au droit à l’égalité que garantissent les chartes. (Par. 370 à 372)
Des remarques additionnelles s’imposent quant à la réparation pécuniaire réclamée par certains opposants à la Loi. Cette réparation serait inappropriée même si, par hypothèse, la Cour se penchait sur la conformité de la Loi aux dispositions des chartes à l’application desquelles elle a été soustraite et déclarait, toujours par hypothèse, que la Loi y contrevient. D’une part, une telle déclaration judiciaire n’affecterait en rien l’applicabilité de la Loi, ne la rendrait pas inopérante et n’affaiblirait pas sa force obligatoire. D’autre part, même lorsqu’une loi ne contient pas de disposition dérogatoire, le constat qu’elle enfreint la Charte canadienne ou la Charte québécoise ne peut généralement pas donner prise à une condamnation au versement de dommages-intérêts. (Par. 373-374)
Subsidiairement, à supposer que la Cour soit habilitée à statuer sur la conformité de la Loi aux dispositions des chartes visées par la dérogation, la doctrine des questions théoriques commanderait qu’elle s’abstienne néanmoins d’accorder un remède déclaratoire. En effet, la question de savoir si la Loi enfreint les libertés de religion et d’expression ou le droit à l’égalité est une question théorique dans la mesure où la reconnaissance d’une contravention n’est pas de nature à entraîner quelque conséquence juridique pratique : la Loi continuerait de s’appliquer même en cas d’entorse. Qui plus est, les conditions qui permettent à un tribunal de répondre à une question malgré son caractère théorique ne sont pas réunies en l’espèce. (Par. 378, 403-404)
* * *
Quelques observations additionnelles s’imposent sur l’usage des dispositions de dérogation et sur le rôle des institutions démocratiques.
Le législateur qui recourt à l’art. 33 de la Charte canadienne prive les justiciables du droit de contester la loi en alléguant que celle-ci contrevient à certains de leurs droits fondamentaux. C’est toutefois la Constitution elle-même qui, par le biais de l’art. 33, retire aux tribunaux la fonction qu’ils exercent ordinairement, laissant aux organes politiques et à l’électorat le soin de trancher la question. L’art. 33 faisant ainsi exception à l’art. 52 de la LC 1982, la Cour ne saurait passer outre et statuer sur une question qui ne relève plus de son pouvoir de contrôle judiciaire. Le même propos vaut pour l’art. 52 de la Charte québécoise. (Par. 409)
Cela dit, on ne peut nier que l’existence même des art. 33 de la Charte canadienne et 52 de la Charte québécoise soulève des critiques. Mais le débat portant sur l’opportunité d’inclure une disposition de dérogation dans une charte des droits et libertés a déjà eu lieu, sur la base des mêmes arguments, et il est clos depuis 1982 dans le cas de la Charte canadienne et depuis 1975 (puis 1982) dans le cas de la Charte québécoise. Ce n’est pas aux tribunaux de colmater les failles, s’il en est, d’un choix constitutionnel (ou législatif) que d’aucuns estiment malavisé. (Par. 410-411)
La société civile, dont on ne peut ignorer le poids et l’importance en matière de protection des droits et libertés, n’est de son côté pas dépourvue de moyens si elle estime inapproprié l’usage que le législateur fait des dispositions de dérogation. Le ressac public et la réaction citoyenne sont aussi un rempart contre l’usage des dispositions de dérogation. De plus, l’électorat détient le pouvoir de défaire le gouvernement qui aurait usé (ou abusé) de la faculté de dérogation que lui confèrent les chartes. (Par. 412-413)
On ne peut pas ignorer non plus le rôle du législateur lui-même dans la défense et la promotion des droits et libertés, surtout lorsque la Constitution « lui donne le dernier mot ». Légiférer en matière de droits et libertés, plus encore lorsqu’il s’agit d’y déroger, n’est pas une affaire ordinaire et mérite une étude complète et rigoureuse. L’affaire relève cependant de la discussion parlementaire. (Par. 414-415)
C. Art. 28 de la Charte canadienne et art. 50.1 de la Charte québécoise (Par. 416 à 514)
À l’instar du juge de première instance, la Cour rejette la contestation de la Loi fondée sur les art. 28 de la Charte canadienne et 50.1 de la Charte québécoise.
L’art. 28 ne crée pas un droit autonome à l’égalité des sexes. Il a une vocation interprétative et fait partie des éléments qui doivent être considérés lorsque les tribunaux se penchent sur le sens, la portée et l’application des art. 2 à 23 de la Charte canadienne. L’art. 28 énonce ainsi une sorte d’« injonction interprétative », intégrée implicitement dans chacun des art. 2 à 23, comme s’il constituait un alinéa ou un paragraphe s’ajoutant à ces dispositions. Or, dans la mesure où l’art. 33 de la Charte canadienne permet au législateur de déroger aux art. 2 et 7 à 15, il se trouve à permettre d’y déroger également sous ce rapport. Le par. 33(1) ne comporte en effet aucune limite à cet égard. L’art. 28 ne peut pas mettre l’art. 33 en échec, que ce soit en conditionnant son utilisation, en neutralisant son effet ou en excluant le par. 15(1) de son champ d’application (dans le cas d’une discrimination fondée sur le sexe). L’art. 28 ne peut donc faire obstacle à l’application de l’art. 34 de la Loi, disposition qui, conformément à l’art. 33 de la Charte canadienne, déroge aux art. 2 et 7 à 15. La Loi ne saurait être invalidée, en tout en partie, au motif qu’elle contreviendrait à l’art. 28. (Par. 505-506)
Ce raisonnement est transposable à l’art. 50.1 de la Charte québécoise. Par sa vocation interprétative, l’art. 50.1 a le même effet que s’il était intégré à chacun des articles 1 à 48 de cette charte. Ainsi, dès lors que le législateur soustrait une loi ou une disposition à l’un ou l’autre des art. 1 à 38 de la Charte québécoise, comme il l’a fait en l’espèce (art. 33 de la Loi), les droits et libertés auxquels il déroge ne sont plus effectifs et n’offrent plus de protection aux personnes qui s’en prévaudraient autrement. L’art. 50.1, privé de son substrat, n’a plus d’application, du moins tant que la disposition dérogatoire est en vigueur. (Par. 507 à 514)
D. Art. 23 de la Charte canadienne (Par. 515 à 615)
De l’avis de la Cour, le juge de première instance a erré en concluant que certaines dispositions de la Loi contreviennent à l’art. 23 de la Charte canadienne, disposition consacrant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité.
Dans l’interprétation et l’application de l’art. 23, il faut d’abord se soucier du sort fait aux droits des titulaires ou des ayants droit visés par la disposition, puis de l’impact que l’atteinte à ces droits peut avoir sur la situation des autres bénéficiaires du régime, tels les élèves du primaire et du secondaire ou les « établissements » destinés à les accueillir. Après tout, la Charte canadienne introduit l’art. 23 sous la rubrique « Droits à l’instruction dans la langue de la minorité ». Or, aucun ayant droit n’est préjudicié ici. Rien dans la Loi n’affecte de quelque façon que ce soit l’emploi de la langue anglaise dans les programmes d’enseignement. Rien ne restreint non plus son usage en contexte scolaire, que ce soit par les élèves, dans les bureaux des commissions scolaires ou encore dans les écoles où les membres de la minorité linguistique exercent leurs professions comme enseignants, professionnels de soutien pédagogique, gestionnaires d’école ou autrement. Est plutôt en cause ici une restriction sur le recrutement du personnel, laquelle demeure cependant étrangère à toute considération linguistique. (Par. 605)
Faire droit à l’argumentaire des parties opposées à la Loi constitutionnaliserait artificiellement une pratique qui n’a strictement rien à voir avec la langue anglaise telle qu’elle est enseignée et utilisée par la minorité linguistique du Québec en milieux scolaires primaire et secondaire. On tente de justifier ce raisonnement, qui tient au mieux de l’extrapolation normative, en invoquant la faculté pour les établissements issus de l’art. 23 de perpétuer et de promouvoir la « culture » particulière qu’on dit véhiculée dans le réseau scolaire de langue anglaise, culture qui favoriserait la diversité, notamment religieuse. La notion polymorphe de « culture », entendue ici comme une notion d’ordre ethnologique ou sociologique, est certainement plus vaste que celle de « langue de la minorité ». Elle est même potentiellement fort extensible. Cette notion embrasse en effet plusieurs choses qui ont peu à voir, ou n’ont rien du tout à voir, avec la langue en tant que telle. (Par. 607-608)
Ce qui serait valorisé selon les opposants à la Loi, c’est une culture de l’ouverture, de la diversité, de l’héritage multiculturel canadien et du pluralisme, en particulier sur le plan religieux. En ce qui concerne le multiculturalisme et la diversité culturelle, il est vrai que l’art. 27 de la Charte canadienne fait explicitement une place dans la Constitution au « patrimoine multiculturel des Canadiens ». L’art. 27 doit cependant être concilié avec l’art. 23, où il n’est nulle part question de minorités culturelles autres que la minorité linguistique anglophone et la minorité linguistique francophone, seules titulaires de droits en vertu de cette disposition. (Par. 609)
Cela ne veut pas dire qu’on ne peut concevoir un lien rationnel entre la langue d’une minorité linguistique visée par l’art. 23 et la culture de cette minorité, celle qui est imprégnée de sa langue, celle dont la langue est le support même. En l’occurrence, toutefois, il n’est pas question du rapport étroit, voire fusionnel, entre une langue minoritaire protégée par l’art. 23 et la culture qu’elle diffuse là où l’usage de cette langue est suffisamment répandu. On tente plutôt d’agglutiner autour de la notion de « culture » des éléments qui n’ont aucun rapport direct ou même de simple proximité avec la langue. Dans le meilleur des cas pour les parties opposées à la Loi, lequel n’est pas démontré, de tels éléments se situent à la périphérie de la notion de culture. Sont ainsi introduites devant la Cour des demandes qui, à la lumière de la jurisprudence pertinente, n’ont rien de commun avec les revendications qui, au cours des trente‑cinq ou quarante dernières années, furent jugées recevables et fondées dans le cadre de l’art. 23 de la Charte canadienne. En faisant droit à ces demandes, le jugement de première instance prête à l’art. 23 une portée qu’il n’a pas. Ce faisant, il conclut erronément que la Loi enfreint cette disposition. Il y a donc lieu d’intervenir pour réformer le jugement sur ce point et pour casser son dispositif. (Par. 610 à 614)
E. Art. 3 de la Charte canadienne (Par. 616 à 698)
La Cour confirme les conclusions du juge de première instance fondées sur l’art. 3 de la Charte canadienne, disposition qui protège le droit à l’éligibilité aux élections législatives.
La Cour ne peut reprocher au juge d’avoir étudié la question de l’existence d’un privilège parlementaire dans le cadre de son analyse sous l’art. 3. Vu l’ambiguïté réelle découlant des observations du Procureur général du Québec (« PGQ ») sur cette question en première instance, le juge pouvait raisonnablement comprendre que celui‑ci invoquait le privilège parlementaire comme moyen de défense. La situation est toutefois différente en appel, à la lumière notamment des précisions apportées par le PGQ et de l’intervention du Président de l’Assemblée nationale, qui, tous deux, demandent à la Cour de ne pas se prononcer sur le sujet. Au regard des circonstances devant elle, la Cour estime inopportun de statuer sur l’existence (ou l’inexistence) d’un privilège parlementaire. (Par. 637, 642 à 644)
À l’instar du juge de première instance, la Cour conclut que l’effet conjugué du premier alinéa de l’art. 8 et du par. 1° de l’annexe III de la Loi (obligation pour les députés de l’Assemblée nationale d’exercer leurs fonctions à visage découvert) porte atteinte au droit à l’éligibilité aux élections législatives garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne.
Contrairement à ce que soutient le PGQ, la contestation constitutionnelle fondée sur l’art. 3 ne repose pas sur une situation purement théorique et hypothétique. Le dossier comporte les éléments nécessaires pour statuer sur la portée et, le cas échéant, la violation de cet article. (Par. 661-662)
La protection conférée par l’art. 3 de la Charte canadienne va au-delà du simple droit d’être candidat à une élection; elle inclut le droit de siéger en tant que député fédéral ou provincial une fois élu. Ce droit ne comporte par ailleurs aucune limite interne. Dès lors, dans la mesure où le PGQ a choisi de ne pas invoquer l’existence d’une limite constitutionnelle qui circonscrirait la portée de l’art. 3 (comme un privilège parlementaire), force est de conclure que l’art. 8 al. 1, conjugué au par. 1° de l’annexe III de la Loi, y porte atteinte. En effet, la combinaison de ces dispositions impose à toute personne élue au terme d’une élection provinciale l’obligation d’exercer ses fonctions de député à visage découvert. En pratique, cela signifie qu’une personne dont les croyances religieuses sincères l’obligent à porter un signe religieux qui couvre son visage (comme le niqab et la burqa) ne pourrait exercer les fonctions d’un député de l’Assemblée nationale. Cette exigence constitue une limite, une restriction que l’on impose à la personne qui désire briguer le suffrage de ses concitoyens. Les personnes qui portent un signe religieux couvrant leur visage (c.-à-d., dans le contexte sociologique actuel, les quelques femmes musulmanes qui portent le niqab ou la burqa par conviction religieuse) sont ainsi privées du droit de jouer un rôle significatif dans le processus électoral, puisque rien ne leur sert d’être candidates à une élection si elles ne peuvent, par la suite, exercer les fonctions découlant de cette élection. (Par. 668, 676 à 678)
Le choix du PGQ de ne présenter aucune preuve et de ne faire aucune observation pour s’acquitter du fardeau qui lui incombe de justifier cette atteinte en vertu de l’article premier de la Charte canadienne revêt ici une importance capitale. Bien qu’il puisse arriver que certains éléments de ce fardeau soient « manifestes ou évidents en soi », ou encore puissent s’appuyer sur la logique et la raison ou la connaissance d’office, tel n’est pas le cas en l’espèce. En l’absence de preuve ou même d’observations de la part du PGQ pour justifier l’atteinte, la Cour ne peut entreprendre de son propre chef une analyse fondée sur l’article premier. Elle n’a donc d’autre choix que de constater que l’atteinte à l’art. 3 de la Charte canadienne n’est pas justifiée. (Par. 684-685)
La Cour partage également la conclusion du juge de première instance selon laquelle les par. 1° et 6° de l’annexe II, lus en conjonction avec l’art. 6 de la Loi, ne portent pas atteinte à l’art. 3 de la Charte canadienne.
Malgré l’interprétation généreuse que doit recevoir l’art. 3, rien ne permet de conclure que le droit à l’éligibilité aux élections législatives qu’il consacre englobe celui d’être nommé au sein du Conseil exécutif à titre de ministre de la Justice ou élu à la présidence ou à la vice‑présidence de l’Assemblée nationale par les députés. Cette nomination et cette élection ne sont pas le fruit de l’exercice du droit de vote des citoyens, mais résultent de décisions prises par des tiers (le premier ministre et l’ensemble des députés). Elles s’inscrivent dans un tout autre registre, postérieur à l’exercice des droits démocratiques protégés par l’art. 3 et distinct du processus électoral. (Par. 693)
F. Exercices de dénombrement (Par. 699 à 703)
La Cour conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en rejetant la demande à l’encontre des exercices de dénombrement menés par le gouvernement avant l’adoption de la Loi. La Cour souscrit aux conclusions et au raisonnement du juge sur ce point.
* * *
Conclusion
En somme, et pour récapituler, la Cour, comme le juge de première instance, conclut que :
- la Loi est valide au regard du partage des compétences; (Par. 107, 205)
- la Loi ne contrevient ni aux principes non écrits de la Constitution, ni à l’architecture constitutionnelle, ni à quelque loi ou principe préconfédératif ayant valeur constitutionnelle; (Par. 148, 174-175, 182, 211)
- les art. 33 et 34 de la Loi, qui dérogent respectivement aux art. 1 à 38 de la Charte québécoise et aux art. 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne, sont conformes aux dispositions de dérogation prévues par ces chartes (art. 52 de la première et 33 de la seconde), dispositions dont l’usage est sujet aux seules conditions de forme énoncées par l’arrêt Ford, conditions remplies en l’espèce; (Par. 311)
- en raison de ces dispositions dérogatoires valides, la Loi est soustraite à l’examen judiciaire qui aurait autrement pu en être fait au regard des art. 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne et des art. 1 à 38 de la Charte québécoise et il n’y a pas lieu de se pencher sur la question ni d’envisager un jugement déclaratoire ou une quelconque autre réparation; (Par. 370 à 372, 374-375, 403-404)
- la Loi n’enfreint ni l’art. 28 de la Charte canadienne ni l’art. 50.1 de la Charte québécoise (égalité des sexes); (Par. 505-506, 514)
- l’art. 6 et les par. 1° et 6° de l’annexe II de la Loi (interdiction du port de signes religieux pour les président/vice-présidents de l’Assemblée nationale et le ministre de la Justice) n’enfreignent pas l’art. 3 de la Charte canadienne (éligibilité aux élections législatives); (Par. 693)
- l’art. 8 al. 1 de la Loi, dans son application aux personnes que vise le premier paragraphe de l’annexe III de ladite loi (obligation du visage découvert dans l’exercice des fonctions des membres de l’Assemblée nationale), porte atteinte aux droits que consacre l’art. 3 de la Charte canadienne, sans justification au sens de l’article premier de celle-ci, et doit par conséquent être déclaré inopérant en vertu du par. 52(1) de la LC 1982; (Par. 676 à 678, 684-685)
- les exercices de dénombrement pratiqués par le gouvernement avant l’adoption de la Loi ne dérogent à aucune norme constitutionnelle ou législative. (Par. 701)
Par contre, contrairement au juge de première instance, la Cour est d’avis que la Loi est compatible avec l’art. 23 de la Charte canadienne et n’affecte pas les droits scolaires linguistiques que celui-ci confère aux citoyens appartenant à la minorité anglophone du Québec. Le jugement de première instance est donc infirmé sur ce point. (Par. 614)
Pour ces motifs, la Cour accueille en partie l’appel du Procureur général du Québec et autres (500‑09‑029550-217) et accueille les appels de Pour les droits des femmes du Québec‑PDF Québec (500-09-029549-219) et du Mouvement laïque québécois (500‑09‑029539-210), en ce qui concerne le dossier de première instance 500‑17‑109983‑190 (dossier Commission scolaire English-Montreal et autres) uniquement, sans frais de justice en appel.
La Cour infirme en partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer le dispositif prononcé dans le dossier 500-17-109983-190 (dossier Commission scolaire English-Montreal et autres), que l’on retrouve aux paragraphes 1137 à 1141 de ce jugement, par le suivant :
Dans le dossier 500-17-109983-190 (dossier Commission scolaire English‑Montreal et autres) :
[1137] REJETTE la demande de révision judiciaire et en jugement déclaratoire de la Commission scolaire English-Montreal, Mubeenah Mughal et Pietro Mercuri; et les interventions au soutien de cette demande;
[1138] Sans frais de justice.
Les autres appels, appels incidents et interventions sont rejetés, sans frais de justice en appel.
Texte intégral de l’arrêt : Constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État![]() (3 Mo)
(3 Mo)
English Translation of the Judgment of the Court: Constitutionality of the Act respecting the laicity of the State ![]() (2 Mo)
(2 Mo)