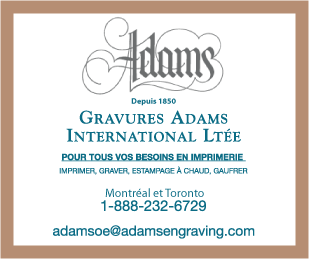Le Québec s’est-il vraiment fait « voler » le Labrador ?

Sur Twitter, c’est facile de transformer ses rêves en réalité. C’est un peu ce qu’a fait le député péquiste Sylvain Gaudreault en annonçant son projet de loi sur la souveraineté environnementale du Québec en avril 2022 : il a illustré son gazouillis avec une carte du Québec… qui incluait le Labrador. Il n’en fallait pas plus pour relancer une vieille légende : le « vol du Labrador ».
L’État québécois n’a jamais reconnu officiellement la décision du Conseil privé de Londres de 1927 qui attribuait à Terre-Neuve le Labrador — une grosse mordée de presque 300 000 km2 dans la péninsule québécoise, soit à peu près la taille de l’Italie. Encore aujourd’hui, sur les cartes routières et dans les livres d’histoire ou de géographie, la limite sud du Labrador (le 52e parallèle) est toujours désignée par la mention « tracé du Conseil privé de 1927 (non définitif) » ou une variante sur ce thème. Chaque fois qu’est abordé le sujet d’une mine de fer ou d’un projet hydroélectrique aux confins de l’Ungava, ou que des Innus du Québec partent chasser le caribou dans l’arrière-pays nord-côtier, se pose à nouveau la question de savoir où passe la frontière québéco-terre-neuvienne, et s’il y en a une tout court.
Le Labrador fait partie des revendications traditionnelles des nationalistes québécois, qui parlent de fraude, d’amputation ou de vol. « Un vol judiciaire », dénonçait René Lévesque en 1968 au moment de la création du Parti québécois. Pascal Bérubé, député du PQ dans Matane-Matapédia, s’est fendu d’une déclaration sur ce thème à l’Assemblée nationale en 2010.
Pascal Bérubé admet ne pas avoir lu le rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec (CEITQ), une lecture pourtant essentielle pour qui se passionne pour les frontières de la province québécoise. La CEITQ a été créée en 1966 par le premier ministre Daniel Johnson père alors qu’il négociait le contrat de Churchill Falls, une centrale hydroélectrique géante construite par Hydro-Québec à la demande de Terre-Neuve pour harnacher le fleuve Churchill, au milieu du territoire contesté. Cette commission présidée par l’éminent géographe Henri Dorion avait pour mandat de faire la lumière sur la définition du territoire québécois, en se penchant notamment sur la très épineuse question du Labrador. Pendant six ans, elle a épluché et analysé des milliers de pages d’études, de correspondance et de cartes. À lui seul, le Labrador occupe 18 des 33 tomes de l’impressionnant rapport, qui emplit tout un rayon de la collection nationale de la Grande Bibliothèque.
Conscients de ramer à contre-courant, les quatre commissaires, appuyés par un conseiller technique et un secrétaire, sont arrivés, en 1972, à la « dure conclusion » qu’il n’existe aucune contestation possible quant au droit de Terre-Neuve sur ce territoire. La lecture des deux tomes du rapport final (839 pages) ne laisse planer aucun doute : la décision du Conseil privé de Londres était légitime et incontestable. « Bien des nationalistes québécois ont encore mal à “leur Labrador”, mais que voulez-vous, ce sont des prétentions non étayées qui ne reposent sur rien », explique aujourd’hui Jean-Paul Lacasse, professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, qui fut secrétaire de la CEITQ. « La sentence de 1927 ne comporte aucune fausseté flagrante ni preuve de fraude. Toute contestation judiciaire serait vouée à l’échec. C’est vraiment à contrecœur que nous sommes arrivés à cette conclusion. »
***
L’ « affaire du Labrador » s’est amorcée en 1902, mais cette terre de rivières puissantes et de fleuves majestueux, au sous-sol gorgé de métaux, cette terre habitée depuis des milliers d’années par des Inuits et des Innus et où vivent aujourd’hui près de 26 500 personnes, a suscité toutes les convoitises au fil du temps. Les premiers peuples ont des droits ancestraux ou de traité sur ce territoire. Les Français et les Britanniques, et plus tard les Canadiens, les Québécois et les Terre-Neuviens, eux, se sont battus (à coups de mousquetons, de maillets de juge, de billets de banque et de piquets d’arpentage) pendant trois siècles pour en prendre le contrôle effectif.
Ainsi, pour la période du Régime français, la CEITQ a déterré de nombreuses traces de concessions seigneuriales pour la chasse au phoque sur toute la Côte-des-Esquimaux (future Côte-Nord) jusqu’à l’embouchure du fleuve Churchill. Les dernières concessions ont été accordées en 1753.
Ça, c’est pour le Labrador côtier. Car il existe aussi un Labrador intérieur, dont la définition est restée obscure pendant plusieurs siècles.
En 1670, le roi Charles II d’Angleterre concède ces terres à son cousin, le prince Rupert. Cette Terre de Rupert, propriété de la Compagnie de la Baie d’Hudson pendant deux siècles, correspond grosso modo à l’Ungava québécois actuel. Le traité d’Utrecht de 1713 (qui met fin à la guerre de Succession d’Espagne) consacre la propriété anglaise des terres du Nord et introduit la notion de ligne de partage des eaux — qui sépare les cours d’eau se déversant vers l’océan Arctique au nord, et ceux allant vers l’est ou le sud. Mais rien ne statue clairement où commence et où finit le Labrador.
De 1763 à 1809, la Couronne britannique entame une sorte de ping-pong labradorien mal défini. À l’issue de la guerre de Sept Ans (et l’acquisition par la Grande-Bretagne des territoires français du Canada), la Proclamation royale de 1763 démembre la Nouvelle-France. À l’est, la « province de Québec » est limitée à la rivière Saint-Jean (un peu avant Havre-Saint-Pierre). Mais avec l’Acte de Québec en 1774, c’est le revirement : à la demande des commerçants anglais, le Québec reprend tout le Labrador. Une décision maintenue avec l’Acte constitutionnel de 1791. Puis, coup de théâtre en 1809 : la côte du Labrador redevient terre-neuvienne, sans plus de définition.
En 1825, pour la première fois, le Parlement britannique trace une ligne sur la table de ping-pong. Elle part de l’anse Sablon (actuellement la baie de Blanc-Sablon) et s’étend « sur 39 milles » (63 km) jusqu’au 52e parallèle. Et c’est tout.
Ce tracé sera diversement interprété, mais les cartographes du Québec et du reste du Canada modifient progressivement leurs cartes pour ajouter au territoire québécois un grand rectangle de Basse-Côte-Nord de près de 200 000 km2, de la rivière Saint-Jean jusqu’à Blanc-Sablon, et délimité au nord par le 52e parallèle.
La rivière Pinware, au Labrador, près de Blanc-Sablon, au Québec.
En 1867 survient un développement important : la Compagnie de la Baie d’Hudson rétrocède la Terre de Rupert à la Couronne britannique, qui transfère le territoire à l’État fédéral canadien en 1870. Le Labrador demeure terra nullius (« territoire qui n’appartient à personne ») — les Autochtones étant ignorés de tous à l’époque.
La partie s’accélère en 1898 et en 1912 : Ottawa et Québec votent ce qu’on appelle les « lois parallèles », qui cèdent la Terre de Rupert à l’État québécois en y ajoutant de grandes sections du Labrador. En 1898, c’est la section au sud de la rivière Eastmain qui passe sous contrôle québécois, mais aussi tout l’arrière-pays de la Côte-Nord jusqu’au fleuve Churchill. En 1912, tout le reste de l’Ungava passe au Québec, sauf la côte du Labrador, qui demeure indéfinie.
Par ailleurs, à compter de 1843, des Québécois et d’autres Canadiens occupent progressivement le territoire. De nombreuses expéditions géologiques et géographiques sont menées afin de faire l’inventaire complet de la fosse du Labrador (cette large bande de terre riche en minéraux, longue de 1 200 km) et du bassin du fleuve Churchill en vue de leur exploitation (mines, électricité, chemins de fer). Les missionnaires québécois sont présents dans la zone en 1866. En 1891, l’équivalent du ministère des Ressources naturelles de l’époque publie des relevés de l’arrière-Côte-Nord jusqu’au bassin du fleuve Churchill. Rien de cela ne sera présenté devant le Conseil privé de Londres en 1927.
Quand l’« affaire du Labrador » s’amorce en 1902, la feuille de pointage se lit donc ainsi : le Québec a récupéré à peu près tout le Labrador, sauf la côte (non définie).
Or, Terre-Neuve, toujours une colonie britannique (elle entrera dans la Confédération en 1949), accorde une concession forestière à une compagnie néo-écossaise. Un immense triangle, centré sur l’embouchure du fleuve Churchill, chevauche en partie un territoire que le Québec considère comme sien depuis 1898.
L’équivalent du ministre des Ressources naturelles de l’époque découvre le pot aux roses en lisant la revue The Canada Lumberman. Le Québec en réfère à Ottawa, d’autant que la concession empiète également sur les terres fédérales de la rive gauche du Churchill. Le Conseil privé du Canada conclut que Terre-Neuve n’est pas dans son droit.
Les gouvernements concernés, du Canada, du Québec et de Terre-Neuve, conviennent qu’il faut trancher. En 1907, les deux dominions liés à l’Empire britannique choisissent de porter la cause devant le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Il s’agit de l’instance suprême, ce qui signifie que la décision sera finale et sans appel.
Ce qui se prépare n’est cependant pas un procès, mais un arbitrage. Contrairement à un procès, qui suit un protocole préétabli sur lequel les parties n’ont aucun pouvoir, l’arbitrage impose aux parties de choisir leur arbitre. De plus, elles doivent s’entendre au préalable sur l’objet de l’arbitrage et le protocole, c’est-à-dire la manière de procéder. Dans ce cas-ci, elles mettront 15 ans pour y parvenir.
Comme l’explique la CEITQ, qui a potassé une foule de documents obscurs, le référé (compromis d’arbitrage) de 1922 partait du principe qu’une frontière existait au Labrador et que celle-ci devait être définie sur la base des textes existants. (Autrement dit, il n’était pas question de prétendre qu’il n’y avait pas de frontière et que Terre-Neuve n’y avait aucun droit.)
Les cercles nationalistes ont souvent dénoncé le fait que tout ce processus s’est déroulé dans le dos du Québec — c’était notamment la position du Parti québécois lors de sa fondation. Or, les commissaires de la CEITQ soutiennent le contraire. « Il est vrai que le nom du Québec n’apparaît nulle part, ni même dans la décision, écrivent-ils. Mais l’étude des documents officiels montre que c’est le gouvernement du Québec en accord avec Terre-Neuve qui a demandé au gouvernement du Canada de régler le problème en le soumettant au Conseil privé. […] L’abondante correspondance montre la participation du Québec au dossier. »
***
La cause est entendue à Londres en 1926 et le Québec y dépêche ses avocats, précise la CEITQ. L’essentiel du débat consiste à déterminer où commence et où s’arrête la « côte » du Labrador. Trois théories sont étudiées, explique la CEITQ :
- La côte est une bande côtière « d’un mille » (1,6 km) de profondeur s’étendant sur près de 2 000 km ;
- La côte est une bande de 39 milles (63 km) qui correspond au segment défini dans la Loi impériale de 1825 ;
- La côte comprend tout l’arrière-pays jusqu’à la ligne de partage des eaux.
Il ressort des documents épluchés par la CEITQ que le Canada a très mal défendu sa cause en audience. Les trois procureurs qui ont représenté le Canada à Londres — dont deux avaient été nommés par Québec — ont commencé par dire qu’il ne pouvait pas y avoir de frontière. Par la suite, ils ont affirmé que la frontière ne pouvait être que la plus mince bande littorale, ce qui contredisait la seule définition claire (Loi impériale de 1825), qui faisait remonter la frontière à 39 milles à l’intérieur des terres. Le Canada a encore affaibli sa position en ne faisant valoir aucun acte d’occupation.
Cette défense était très faible, considérant le compromis d’arbitrage négocié — auquel le Québec avait participé. En contredisant les textes existants sans rien proposer de logique en retour, le Canada laissait Terre-Neuve définir le débat. Et c’est ce qui s’est produit.
Les procureurs de Terre-Neuve ont fait une démonstration que la CEITQ qualifie de brillante. Ils ont d’abord présenté tous les textes de traités et de lois existants, pour ensuite exposer les admissions partielles du Canada et du Québec quant à la thèse terre-neuvienne (plusieurs cartes publiées par le Canada au XIXe siècle montraient la frontière à la ligne du partage des eaux ou fixaient la frontière du Québec au 52e parallèle). Évidemment, les procureurs ont mis en valeur tous les faits d’occupation terre-neuvienne officiels et officieux, souvent de nature très anecdotique. Par exemple, ils ont fait valoir que certains juges terre-neuviens avaient déjà foulé le sol du Labrador et ont rappelé les redevances que versait la Compagnie de la Baie d’Hudson à Terre-Neuve pour des concessions de fourrures situées au-delà de la ligne de partage des eaux.
Devant des arguments nettement plus probants de la part de Terre-Neuve, les juges anglais se sont donc attachés à définir la frontière telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ils ont dû se livrer à plusieurs improvisations là où les cartes n’étaient pas claires. Mais aucune de ces imperfections et incohérences n’est de nature à faire annuler la décision, conclut la CEITQ.
***
La sentence arbitrale du Conseil privé passe très mal au Québec, particulièrement dans les cercles nationalistes. Mais les déclarations des élus québécois deviennent moins revendicatrices à partir de 1954, à l’époque où l’on termine le chemin de fer de Sept-Îles, qui traverse une partie du Labrador et qui permettra d’exploiter le minerai de Schefferville, ville québécoise construite sur la frontière pour tirer profit des richesses de la fosse du Labrador.
Dans leur rapport, les commissaires de la CEITQ ont exprimé leur immense surprise par rapport à la position très ambiguë du Québec après la grande mordée terre-neuvienne : malgré de nombreuses affirmations contestant ce jugement, aucun gouvernement québécois, y compris le parti de René Lévesque, n’a fait un seul geste concret dans le sens de sa position.
Même si le Québec maintient dans sa Loi sur la division territoriale et sur ses cartes routières des descriptions qui contredisent ou mettent en doute la décision de 1927, les gouvernements successifs ont reconnu ce tracé de différentes manières. La CEITQ consacre tout un tome à une foule de petits gestes administratifs, législatifs ou réglementaires qui vont dans le sens d’une reconnaissance explicite ou implicite de la frontière de 1927.
« L’absence d’exercice des compétences québécoises sur le Labrador est quasi totale, constate le professeur Jean-Paul Lacasse. Même pour les gisements à cheval sur la frontière et exploités par la même compagnie, le Québec n’a jamais contesté la répartition des redevances entre les deux provinces. Jamais. »
Les travaux de la CEITQ s’arrêtent en 1972, mais le portrait n’a pas vraiment changé depuis. Jusqu’au complexe hydroélectrique de la rivière Romaine, qui prend sa source scrupuleusement dans la zone québécoise. À Hydro-Québec, on explique avoir adopté une définition volontairement restrictive de la frontière pour éviter tout débat interprovincial.
Terre-Neuve a fait appel au Québec pour sauver in extremis son projet de barrage sur le fleuve Churchill, mais le Québec n’a pas profité de l’occasion pour négocier des pans de territoire.
Valérie Vézina, professeure de sciences politiques à l’Université polytechnique Kwantlen, en Colombie-Britannique, a fait sa thèse doctorale sur le nationalisme terre-neuvien, en plus d’enseigner quatre ans à l’Université Memorial à Terre-Neuve. « Comme Québécoise, ça me mettait dans une drôle de position. Il existe un nationalisme terre-neuvien aussi fort que celui du Québec, même s’il s’exprime différemment. Ça s’est traduit longtemps par le refus de rejoindre le Canada. De nos jours, les Terre-Neuviens manifestent beaucoup leur nationalisme par leur attachement au Labrador et par l’exercice de leur compétence sur ce territoire, particulièrement sur le plan économique. »
Dans les faits, les Terre-Neuviens ont largement occupé ce territoire, où les Québécois sont rares, comme l’explique Stéphanie Chouinard, professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada, qui a dénoncé sur Twitter la carte présentée par Sylvain Gaudreault pour son projet de loi 391 sur la souveraineté environnementale. « Avec les années, dit-elle, il s’est installé une frontière démographique qui est bien réelle. J’ai grandi au Labrador, à une époque où il y avait 12 000 habitants à Labrador City et Wabush. Nous étions 500 francophones. C’était exactement le portrait inverse de ce qu’on voyait à Fermont. »
Comme le soulignent Jean-Paul Lacasse et le rapport de la CEITQ, le Labrador est maintenant verrouillé juridiquement. « Mais le Québec aurait quand même pu récupérer ce territoire par des négociations politiques. Malheureusement, il a raté plusieurs belles occasions. »
La liste est longue. Dans les années 1930, le dominion de Terre-Neuve, en quasi-faillite, était prêt à vendre le Labrador, et Québec n’a rien fait. Il n’a pas non plus saisi la perche en 1949 lorsque Terre-Neuve, étranglée financièrement, cherchait à faire partie du Canada et négociait l’Acte d’Union. En 1956 et en 1962, les deux provinces ont discuté de diverses possibilités d’échange de territoires, sans suite. Dans les années 1960, Terre-Neuve a fait appel au Québec pour sauver in extremis son projet de barrage sur le fleuve Churchill, mais le Québec n’a pas profité de l’occasion pour négocier des pans de territoire. Pas plus qu’en 1998, à l’époque où les premiers ministres Lucien Bouchard et Brian Tobin annonçaient leur intention de développer conjointement le Bas-Churchill — l’idée a été abandonnée en 2003. Et en 2001, quand Terre-Neuve a voulu amender la Constitution pour prendre le nom de Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec n’a pas levé le petit doigt.
Bref, le train (du Labrador) est bel et bien passé.
Source: L’Actualité