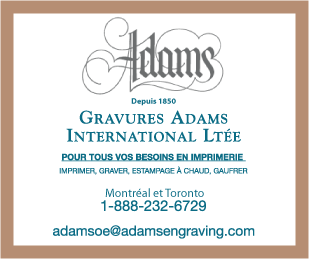NELSON, WOLFRED

NELSON, WOLFRED, médecin, homme politique et patriote, né à Montréal le 10 juillet 1791, troisième fils de William Nelson et de Jane Dies ; il épousa en 1819 Charlotte-Josephte Noyelle de Fleurimont, et de ce mariage naquirent sept enfants ; décédé à Montréal le 17 juin 1863.
Il y a peu de chose dans les origines familiales de Wolfred Nelson ou dans les débuts de sa vie qui eût pu laisser croire qu’il deviendrait un adversaire de la mauvaise administration britannique au Canada et un champion des droits civils des Canadiens français. Sa mère était fille d’un riche propriétaire terrien de New York qui avait perdu ses biens pour être resté loyal à la couronne pendant la Révolution américaine. Le père de Wolfred, un maître d’école formé à Londres, était venu dans la province de Québec en 1781 et s’y acquit une telle réputation comme instituteur que les autorités coloniales britanniques lui accordèrent un excellent salaire annuel pour l’inciter à rester dans la colonie. Wolfred avait trois ans quand sa famille déménagea à Sorel (le nom officiel était William Henry, mais on disait communément Sorel) où son père ouvrit une école. C’est là, à l’intérieur des palissades de l’avant-poste britannique situé à l’embouchure de la rivière Richelieu, qu’il grandit. La famille vivait près de la résidence d’été des gouverneurs britanniques, et Wolfred fréquenta l’école de son père où il eut pour compagnons les fils des officiers britanniques.
À l’âge de 14 ans, Wolfred Nelson fut mis en apprentissage chez le docteur C. Carter, de l’armée britannique ; il reçut son permis de médecin en février 1811. Il demeura à Sorel, souffrant, selon les mots d’un biographe, « les pénibles corvées d’un petit hôpital militaire », alors qu’il espérait de l’avancement au sein de l’armée. Il apprit, en janvier 1812, qu’il allait être recommandé au poste de médecin d’hôpital militaire par le médecin d’état-major de Sorel, et, quelques semaines après, ses espérances de faire une carrière médicale au sein de l’armée se ravivèrent davantage encore par suite de la déclaration de guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Immédiatement, Nelson présenta une requête au gouverneur sir George Prevost* pour obtenir une commission ; il fut nommé médecin du 5e bataillon de la milice incorporée. C’était là un point tournant dans sa vie, bien que dans une direction inattendue. Jusqu’à la guerre de 1812, le monde de Nelson avait été celui de l’élite britannique de Sorel – tout humble qu’elle fût – et les préjugés de cette élite étaient les siens. « Dans ma jeunesse », rapportait-il bien des années plus tard, « j’étais un ardent tory et j’étais porté à détester tout ce qui était catholique et canadien-français, mais une connaissance plus intime de ces gens changea mes vues. » Cette intimité commença avec son affectation à la milice. Le quartier général du bataillon était à Saint-Denis, un prospère village canadien-français de quelque 500 âmes situé sur le Richelieu, à plusieurs milles au sud de Sorel. En septembre 1813, quand on fit appel au bataillon pour parer à une attaque à laquelle on s’attendait de la part des Américains, Nelson en était le seul officier de langue anglaise. Après la guerre, il ouvrit un bureau de médecin à Saint-Denis.
La conversion politique de Nelson aux idées réformistes était aussi commencée, et, en 1827, il entra dans la politique active. Entrée dramatique, puisqu’il choisit de se porter candidat à l’Assemblée dans la « circonscription royale » de William Henry, laquelle comprenait sa propre ville de Sorel et était traditionnellement le fief du gouverneur. Pendant la campagne, il se révéla un ennemi implacable de l’ordre établi. Son adversaire, James Stuart*, procureur général du Bas-Canada, était publiquement appuyé par le gouverneur, lord Dalhousie [Ramsay*]. Au cours d’une assemblée, Nelson interrompit Dalhousie, qui parlait en faveur de Stuart, l’informa que sa conduite était inconstitutionnelle, le forçant ainsi à mettre fin à ses activités dans la campagne électorale. Nelson remporta l’élection par deux voix, « à l’étonnement et à l’indignation de la partie respectable des habitants », selon la Montreal Gazette. C’est un Stuart outragé qui entreprit alors une harassante série de démarches judiciaires pour faire annuler l’élection. Bien plutôt, les pratiques électorales corrompues dont on fit état amenèrent la destitution de Stuart comme procureur général en 1831. « Les lois, écrivit Nelson, doivent être observées autant par ceux qui gouvernent que par ceux qui sont gouvernés. »
Pour des raisons qui encore maintenant nous échappent en partie – peut-être était-ce simplement la difficulté de remplir ses devoirs de médecin pendant qu’il siégeait à l’Assemblée – Nelson ne sollicita pas sa réélection en 1830. Les sept années qui suivirent furent peut-être celles où il obtint le plus de succès. Il visita l’Europe, notamment la Grande-Bretagne, pour y étudier les institutions médicales, établit une grosse distillerie à Saint-Denis et fut nommé juge de paix. Ses conceptions politiques, toutefois, ne s’adoucirent point à la suite de ses succès matériels. S’il est quelque chose, il devint de plus en plus radical à mesure que les abus de l’oligarchie au pouvoir furent plus apparents. L’assassinat à Sorel de son ami et allié politique Louis Marcoux, au cours des élections de 1834, et l’acquittement subséquent, par un jury truqué, de celui qui fut accusé du meurtre, enflamma particulièrement sa colère. Lors d’une entrevue qu’il eut avec le gouverneur, lord Gosford [Acheson*], en janvier 1836, Nelson protesta contre les abus du Conseil exécutif et donna cet avertissement que « si les Habitans étaient laissés à eux-mêmes et si leurs chefs étaient insultés ou injuriés à Montréal, ce serait le signal d’une guerre d’extermination ».
À la vérité, le conflit entre le parti patriote (formé de Canadiens français, sauf un certain nombre d’exceptions comme Nelson) et le parti constitutionnel (formé d’anglophones) s’intensifia bientôt, les échanges verbaux – éditoriaux, discours, résolutions – le cédant aux coups de fusils, et, dans les deux cas, Nelson était aux premiers rangs. En mai 1837, il organisa la première des nombreuses « assemblées contre les mesures coercitives » qui furent tenues dans la province cet été-là et y proposa sa première résolution condamnant les mesures antidémocratiques récemment mises de l’avant par lord John Russell pour apporter une solution à l’inquiétante situation politique du Bas-Canada. À cause du rôle qu’il joua au cours de cette assemblée, Nelson fut relevé de ses fonctions de juge de paix. En octobre, il fut porté à la présidence de l’assemblée des six comtés, où, de nouveau, il proposa la première résolution, dictée par la colère : « quand une forme de gouvernement, quelle qu’elle soit, devient destructrice […] c’est le droit du peuple de la modifier ou de l’abolir ». Le 16 novembre 1837, le gouvernement riposta en émettant, illégalement, des mandats contre Nelson et 25 autres Patriotes sous l’inculpation de haute trahison. Peu après, Louis-Joseph Papineau* et Edmund Bailey O’Callaghan* rejoignirent Nelson à Saint-Denis, où ils décidèrent de résister à l’arrestation, de fournir au peuple des armes et des munitions et de déclarer l’indépendance du Bas-Canada le 4 décembre 1837.
Les autorités britanniques, cependant, avaient décidé bien avant cette date de passer à l’action. Quand elles apprirent que les Patriotes occupaient Saint-Charles et que Papineau était en compagnie de Nelson à Saint-Denis, elles lancèrent, dans la nuit du 22 novembre, une double attaque contre les deux places fortes des Patriotes. Une brigade aux ordres du colonel George Augustus Wetherall partit de Chambly et marcha sur Saint-Charles en même temps qu’une autre brigade, aux ordres du colonel Charles Stephen Gore, quittait Sorel pour aller secrètement s’emparer de Saint-Denis, que, selon un officier qui participait à l’expédition, « l’on ne supposait pas être fortement défendu ». La tactique britannique échoua. Prévenu avant l’aube, le 23, de l’approche des soldats par la capture d’un officier britannique, Nelson alla reconnaître l’importance de leurs forces. Les récits ne concordent pas sur ce qui se passa exactement par la suite, mais il semble que Nelson soit revenu à Saint-Denis décidé à livrer bataille aux Britanniques. Il donna l’ordre de sonner le tocsin, dépêcha des détachements chargés de détruire les ponts et se mit en mesure de résister en se fortifiant dans deux maisons de pierre à la limite nord du village. Il avait informé Papineau de son voyage pour reconnaître l’ennemi, mais il ne semble pas qu’après son retour il ait discuté avec lui de ses intentions. Aux Patriotes qui étaient avec lui, il dit : « Un peu de courage et la victoire est à nous. »
Les forces en présence à Saint-Denis ont pu paraître grossièrement inégales : un médecin de campagne et sa bande de cultivateurs et d’artisans contre un vétéran de Waterloo et ses compagnies choisies de soldats de carrière aguerris. Mais Nelson avait grandi parmi les soldats britanniques et il n’était pas intimidé à la vue de leurs uniformes. De même, parmi les mécontents de Nelson, hommes décidés, se trouvaient plusieurs tireurs d’élite. D’autre part, bien qu’il fût un assistant quartier-maître général sérieux et assidu, Gore n’était pas un brillant tacticien, et ses hommes faisaient partie d’une armée qui, pour reprendre les mots de Wellington, était un ramassis des « excréments de la terre » ; certains parmi ces hommes n’attendaient qu’une occasion de filer vers les États-Unis. De surcroît, les éléments jouaient en faveur de Nelson. Lui et ses tirailleurs restaient au sec derrière d’épais murs de pierre, pendant que Gore et ses soldats, après avoir marché toute la nuit sous une pluie glaciale de novembre, devaient manœuvrer dans la boue. De 9 heures du matin, environ, jusqu’au milieu de l’après-midi, Gore tenta vainement de pousser ses hommes au-delà des positions des Patriotes. Il fut forcé bien au contraire d’ordonner la retraite.
La victoire de Saint-Denis électrisa le Bas-Canada et fit de Nelson un héros parmi les Patriotes. Même les Britanniques reconnurent, de mauvaise grâce, qu’il fut « de loin plus décidé, plus courageux et plus actif que quiconque parmi ses frères dans la trahison ». Mais, pour les Patriotes, des défaites suivirent la grande victoire et, pis encore, Papineau disparut, « nous laissant tous en plan », comme Nelson le déclara plus tard. Un peu plus d’une semaine s’était à peine passée que les défenseurs de Saint-Denis n’étaient plus que six. Devant la perspective d’un retour imminent de Gore, ils s’enfuirent dans les bois le 1er décembre. Pour Nelson, la suite fut un cauchemar. À Granby, il se retrouva séparé de ses compagnons de Saint-Denis, et sans nourriture il erra pendant dix jours avant d’être capturé par des volontaires près de Stukeley dans les Cantons de l’Est. Il fut alors amené à Montréal pour y subir son procès sous une accusation de haute trahison. « Juste avant son départ », écrivait un ami à Mme Nelson, « il exprima le désir que j’écrivisse quelques lignes pour dire qu’il laissait tous ses biens à sa chère femme et à ses enfants. » Nelson ignorait à ce moment-là que les hommes du colonel Gore avaient brûlé la plupart de ses biens lors de leur retour à Saint-Denis. Mais il n’ignorait pas que la loi martiale avait été décrétée et que la peine encourue pour haute trahison était la mort.
Le procès de Nelson, toutefois, ne fut même pas instruit. Après avoir passé sept mois en prison, lui et sept autres furent exilés aux Bermudes après s’être reconnus coupables, dans une lettre adressée privément à lord Durham [Lambton*], de « rébellion contre la mauvaise administration coloniale ». En octobre 1838, de nouveau, et par un singulier retournement du sort, le désaveu de l’ordonnance de Durham permit aux exilés de quitter les Bermudes. Tôt en 1839, Nelson était parvenu à Plattsburgh, New York, près de la frontière du Bas-Canada. Il y ouvrit un bureau de médecin et y fut rejoint par sa famille. Quand on lui demanda ce qu’il fallait faire pour libérer le Bas-Canada, il répondit simplement : « Pour le moment, il faut laisser le temps et les circonstances faire leur œuvre, même si cela doit être long. »
Le temps et les circonstances travaillèrent particulièrement vite. En 1842, Louis-Hippolyte La Fontaine, un ami qui avait offert d’adopter l’un des enfants de Nelson juste avant que les exilés ne partent pour les Bermudes, devint procureur général du Bas-Canada et introduisit une procédure de nolle prosequi dans le cas de Nelson, lequel quitta Plattsburgh en août, au grand regret des habitants de ce village, et déménagea sa famille à Montréal où, une fois de plus, il ouvrit un nouveau cabinet de médecin.
Bien qu’il eût juré, à son retour, de demeurer loin de la politique canadienne, il ne tint cette résolution que pendant deux ans. En 1844, La Fontaine lui demanda de se porter candidat aux élections à l’Assemblée ; transporté d’indignation à la suite du refus de Downing Street d’admettre le principe du gouvernement responsable, il fut incapable de résister à cette invitation. Pendant les sept années suivantes, il fut député de Richelieu. Au grand scandale des tories, il se fit à nouveau l’interprète anglophone des droits des Canadiens français et fut un avocat déterminé du gouvernement responsable.
Deux fois pendant sa carrière parlementaire, on vit réapparaître cet homme en colère qui avait défié Dalhousie et défait Gore. À la première occasion, en 1848, son adversaire fut Louis-Joseph Papineau. De retour d’exil et membre de l’Assemblée, celui-ci avait commencé à manœuvrer en vue de reprendre à La Fontaine son leadership en faisant appel aux préjugés nationalistes. Nelson était irrité des efforts à peine voilés de Papineau pour rompre l’alliance réformiste qui avait finalement pris le pouvoir. Quand Papineau insinua que la violence en 1837 était attribuable à Nelson, celui-ci se retourna contre le grand homme lui-même et révéla finalement que Papineau avait été tout à fait disposé à recourir à la force et qu’il avait effectivement signé une déclaration d’indépendance dans sa maison. Il fit état aussi de la précipitation de Papineau à fuir Saint-Denis, une demi-heure seulement après le début de la bataille, et il affirma sa conviction que la fuite de Papineau avait amené la défaite finale du mouvement patriote et toute la misère qui s’ensuivit. « C’est peut-être une faveur dont nous devons remercier Dieu que vos projets aient avorté, ricana-t-il, persuadé comme je le suis à présent, que vous auriez gouverné avec une verge de fer. » Seul peut-être un homme de la réputation de Nelson pouvait s’attaquer à un personnage aussi considéré avec un si grand effet. La puissance et la popularité de Papineau en furent fort affectées, mais la propre réputation du héros Nelson se trouva diminuée par la véhémence de son attaque ; il est certain que, dans les années suivantes, il la regretta.
Une seconde explosion se produisit pendant le débat enflammé sur le projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion [V. James Bruce], à la préparation duquel Nelson avait participé. Accablé par les tories qui l’accusaient d’être un rebelle et un traître, Nelson répliqua : « à ceux qui nous appellent, moi et mes amis, des rebelles, je leur dis qu’ils en ont menti par la gorge […]. Je dis en pleine face à ces gentlemen que c’est eux et leurs pareils qui causent les révolutions, qui renversent les trônes, piétinent les couronnes dans la poussière et détruisent les dynasties. » II offrit aussi de retirer sa propre réclamation, bien qu’elle fût valide, pour les pertes qu’il avait subies, « si gratuitement infligées qu’elles furent », mais demanda que ceux qui avaient été d’innocentes victimes fussent remboursés. Quand la sanction royale fut donnée au projet de loi en avril 1849, Nelson eut la satisfaction de savoir que la mesure profiterait matériellement à ses électeurs de la vallée du Richelieu, qu’elle le disculpait des gestes qu’il avait posés 12 ans plus tôt et que, du fait même de son adoption, cette loi établissait le principe du gouvernement responsable pour lequel il avait combattu depuis le début de sa carrière politique, 22 ans plus tôt. Un peu plus d’un an après, il annonçait sa retraite de la politique.
Nelson avait 60 ans, mais il n’allait pas se retirer encore. En reconnaissance pour les services qu’il avait rendus au gouvernement de La Fontaine et de Robert Baldwin*, on lui offrit le poste d’inspecteur des prisons et des asiles de la province, un emploi pour lequel, ironiquement, il était bien préparé. Il s’en expliquait lui-même : « Mon séjour de sept mois à la prison de Montréal m’a donné une connaissance très pratique des questions relatives aux prisons ; les détestables abus qui s’y rencontraient couramment […] et les souffrances injustifiées qui étaient infligées aux prisonniers m’incitèrent à accepter. » Avec l’énergie qui le caractérisait, il transforma une sinécure possible en une fonction importante. Ses rapports sur les prisons, qu’on a qualifiés de « bien écrits », contiennent des renseignements nombreux et précieux.
Il ne se retira même pas de la politique. En 1854, il défaisait Édouard-Raymond Fabre*, un partisan de Papineau, et devenait le premier maire de Montréal élu au vote populaire. Il n’existe pas d’étude sur la carrière de Nelson en politique municipale, mais il semble, à en juger par ses discours, avoir été un administrateur partisan du progrès. En 1855, il prôna une réglementation plus poussée des services publics en engageant des inspecteurs municipaux. Il favorisa des mesures de bien-être en faveur des pauvres, quand il y eut du chômage, et il recommanda au conseil municipal d’étudier sérieusement l’idée de sir James Edward Alexander de créer un parc au sommet du mont Royal. Il se retira de la politique municipale en 1856.
Nelson paraît ne s’être jamais éloigné de sa première profession. Il fut toujours médecin – pour les soldats britanniques blessés après Saint-Denis, au milieu de ses compagnons de prison, parmi les Noirs des Bermudes et sur les quais, à Montréal, pendant l’épidémie de typhus de 1847. Il est reconnu pour avoir fait, avec son fils, le docteur Horace Henry Nelson, la première opération au Canada au cours de laquelle on usa d’anesthésiques. En sa qualité de maire de Montréal, il publia à ses frais une utile brochure, en anglais et en français, sur la prévention du choléra. À l’Assemblée, il élabora une législation relative à l’enseignement et à la réglementation de la profession médicale. On n’est pas surpris de voir qu’il faisait passer la médecine avant la politique. En 1851, il écrivait à son ami William Lyon Mackenzie pour lui dire son regret d’avoir manqué l’ouverture de la session à cause de trois ou quatre cas sérieux de maladie : « J’ai cherché à [les] mettre en d’aussi bonnes mains [que les miennes], mais mes patients ne voudront pas en entendre parler. » Bien que la réputation de Nelson lui vienne des historiens qui ont parlé de son activité politique, il est possible que son apport le plus important se trouve dans sa longue et honorable carrière médicale ; mais les services qu’il a rendus à des milliers de personnes pendant ses 50 années de pratique ne pourront jamais être connus.
Wolfred Nelson a fait preuve, tout au cours de sa vie, de grandes préoccupations humanitaires, et les gestes qu’il a posés à l’occasion de petits événements révèlent combien ces préoccupations concourent, pour leur part, à prendre la mesure exacte de cet homme. Pendant qu’il était transporté aux Bermudes, craignant que certains de ses propos, concernant des occasions de s’évader qu’il avait refusées, ne pussent compromettre son geôlier, il lui écrivit pour rectifier les faits et pour louer son « humanité et ses égards pour les sentiments des prisonniers ». En 1854, il prit la peine d’écrire une lettre qui aida l’impopulaire colonel tory Bartholomew Conrad Augustus Gugy* à se disculper d’allégations de cruauté relatives à 1837. Nelson rappela avec reconnaissance la bonté dont son vieil adversaire Gugy fit preuve envers Mme Nelson après le retour de Gore à Saint-Denis. À l’Assemblée législative de l’Union, en 1845, il prononça son premier discours en français, alors que cette langue était interdite, et, en 1849, au cours de la discussion du projet de loi pour l’indemnisation des pertes subies pendant la rébellion, il appuya un amendement qui l’empêchait de réclamer quoi que ce fût relativement à ses propres pertes. Pendant une froide soirée de janvier 1849, il présida une assemblée convoquée pour promouvoir l’abolition de la peine capitale, qu’il qualifiait d’ « assassinat légal ».
Wolfred Nelson mourut à Montréal le 17 juin 1863, à l’âge de 71 ans. Sur sa tombe, une petite plaque blanche porte les mots suivants : « Ici repose la plus noble réalisation de Dieu, un honnête homme. »
Wolfred Nelson, Practical views on cholera, and on the sanitaty, preventive and curative measures to be adopted in the event of a visitation of the epidemic (Montréal, 1854 ; une édition française est aussi parue à Montréal en 1854).
APC, MG 24, A27, sér.2, 26, pp.631–637, 652s. ; A40, 9, pp.2 273, 2 344, 2 432–2 434, 2 457, 2 475–2 477, 2 574, 2 589 ; 27, pp.8 156, 8170 ; B14 ; B31, l, p.40 ; B34 ; B37, 1, p.118 ; B82 ; RG 4, A1, S-112 ; S-203a ; S-272, pp.73s. ; S-507, pp.73–75 ; S-586, pp.42–42a ; RG 8, I (C series), 281, p.222 ; 1717, p.59 ; RG 9, I, A7, 21.— PRO, CO 42/274, 10s. (mfm aux APC).— Les Patriotes aux Bermudes en 1838, lettres d’exil, Yvon Thériault, édit., RHAF, XVI (1962–1963) : 267–272.— La Minerve, mai–oct. 1848, juin 1863.— Pilot and Journal of Commerce (Montréal), nov.–déc. 1844, janv. 1849.— Vindicator and Canadian Advertiser (Montréal), avril–déc. 1837.— Borthwick, History and biographical gazetteer.— Morgan, Sketches of celebrated Canadians.— Abbott, History of medicine.— Christie, History of L.C., IV, V.— Azarie Couillard-Després, Histoire de Sorel de ses origines à nos jours (Montréal, 1926).— Monet, Last cannon shot.— Wolfred Nelson, Wolfred Nelson et son temps (Montréal, 1946).-B. B. Kruse, The Bermuda exiles, Canadian Geographical Journal (Ottawa), XIV (1937) : 353.